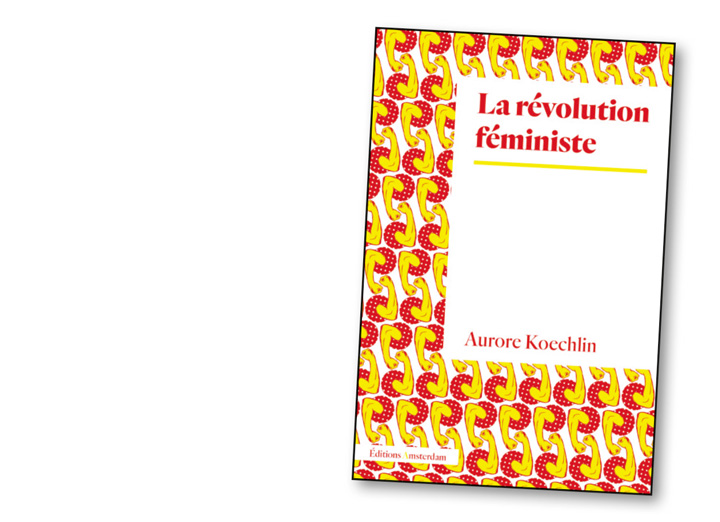Quelle stratégie pour le mouvement féministe ?
Par Aurore Koechlin
Militante féministe et doctorante en sociologie à Paris 1
Depuis le début des années 2010, une nouvelle vague féministe a commencé. Elle a déjà connu trois moments. Elle naît d’abord en Amérique latine, avec l’émergence d’un mouvement contre les féminicides, en particulier en Argentine, autour de l’expression « ni una menos » (« pas une de moins »). Cette lutte n’est pas nouvelle, et date notamment des années 1990 pour faire reconnaître le terme de « féminicide ». Mais elle se réactualise avec l’accroissement des violences faites aux femmes dans un contexte de néolibéralisme débridé.
D’autres revendications émergent par ailleurs : en lien avec les féminicides, l’absence de droit à l’avortement est considéree comme une violence faites aux femmes, d’autant plus qu’elles meurent des avortements illégaux. En Argentine, la lutte évolue donc pour inclure la revendication du droit à l’avortement, autour du maintenant fameux pañuelo verde1. Si en 2018 la loi a été rejetée par le Sénat, le 1er mars de cette année le président argentin Alberto Fernandez a été obligé d’annoncer qu’un nouveau projet de loi allait être présenté devant l’Assemblée, à cause des mobilisations massives qui continuent. Au Chili, lors des mobilisations féministes de mai 2018 et en lien avec les mouvements étudiants, la question de l’éducation au genre et du consentement est également posée. La vague féministe continue au Chili dans le mouvement actuel : en témoigne la chorégraphie « un violeur sur ton chemin », qui a été reprise à l’échelle internationale.
Le deuxième moment de cette nouvelle vague féministe est celui du #MeToo en octobre 2017, dans un contexte qui est celui des Women’s march contre Trump. Puis le mouvement de libération de la parole prend une dimension rapidement internationale. Aujourd’hui, c’est cette dimension qui affecte le plus la France. Enfin, le troisième moment est celui de la construction de la grève féministe internationale pour le 8 mars, suite à l’appel du collectif argentin Ni Una Menos en 2017. Chaque année, un nouveau pays entre dans le mouvement de grève : Italie, État espagnol, Suisse, Belgique, etc. C’est un succès immense : dans l’État espagnol, ce sont respectivement 5 puis 6 millions de personnes qui descendent dans la rue pour le 8 mars en 2018 et 2019. Le 14 juin 2019, en hommage au 14 juin 1991 où plus de 500.000 personnes sont descendues dans la rue, la Suisse enregistre une mobilisation aussi forte qu’en 1991. En Belgique, le « Collecti.e.f 8 maars » qui a émergé et préparé le 8 mars 2019, ce sont 15.000 personnes qui sortent dans la rue. Cette situation doit nous pousser à reposer à nouveaux frais la question de la stratégie dont doit se doter ce mouvement féministe, afin que ces mobilisations soient victorieuses. Cela va à rebours de la tradition féministe française qui a finalement peu posé frontalement la question de la stratégie. Par ailleurs, toute stratégie est liée à une certaine analyse de l’oppression des femmes et des minorités de genre. On ne peut donc poser la question stratégique sans poser la question de l’analyse théorique. C’est pourquoi la réflexion se déploiera en deux temps : tout d’abord, je reviendrai sur la théorie de la reproduction sociale, pour défendre ensuite une stratégie féministe révolutionnaire.
Pour définir l’oppression des femmes et des minorités de genre, je repartirai de la façon dont la théorie de la reproduction sociale l’a conceptualisée depuis une cinquantaine d’années dans le monde anglo-saxon, autour d’autrices comme Silvia Federici ou Lise Vogel. De la même façon que Marx a défini la base matérielle de la domination des travailleur·se·s, en tant qu’appropriation par les capitalistes de la survaleur2, un des grands débats qui a traversé le mouvement féministe est la conceptualisation de la base matérielle de la domination des femmes et des minorités de genre. La plupart des théoriciennes des années 1960 et 1970 avaient fondé cette domination sur le travail domestique des femmes, invisibilisé, gratuit et effectué dans le cadre du mariage hétérosexuel (soin des enfants et des personnes âgées, préparation des repas, entretien de la maison, etc.). La théorie de la reproduction sociale tente d’aller plus loin en analysant cette forme de travail spécifique avec l’aide des outils conceptuels de Marx. Il s’agit dès lors moins d’analyser le travail effectué en le caractérisant de façon descriptive que d’essayer de comprendre ce qui fonde ce travail en tant que travail et d’expliquer sa fonction centrale au sein de l’économie globale du capitalisme.

Linogravure Bureau Tempête-Be Cause Toujours !
La centralité de la reproduction sociale et la centralité des femmes
Au fondement de la théorie de la reproduction sociale est la question que pose Tithi Bhattacharya : « Le marxisme nous apprend que dans le mode de production capitaliste, les travailleur·se·s produisent les marchandises, ce qui est central au système, mais la théorie de la reproduction sociale pose la question : si les travailleur·se·s produisent les marchandises, qui produit les travailleur·se·s.3» Le travail reproductif est précisément le travail qui assure la production et la reproduction des travailleur·se·s. D’une part, il assure la production des futur·e·s travailleur·se·s par la procréation et l’éducation des enfants ; d’autre part, il assure la reproduction des travailleur·se·s par le soin quotidien qui leur est apporté, tant en termes matériels (maison, nourriture, repos) qu’émotionnels (soins psychologiques, affection). Ce travail spécifique a été et demeure encore très majoritairement effectué par les femmes, et il constitue la base matérielle de leur domination. On peut faire l’hypothèse que c’est du fait de leur monopole reproductif biologique qu’elles ont ensuite été assignées à la reproduction sociale comme un tout.
La reproduction est centrale dans l’ensemble des sociétés, et en particulier dans les sociétés capitalistes. En effet, que produit-on lorsqu’on produit des travailleur·se·s ? Ni plus ni moins que la force de travail qui, selon Marx, est la seule marchandise productrice de survaleur. Ainsi, en termes marxistes, le travail reproductif est le travail qui assure la production et la reproduction de la force de travail, et ce à un double niveau, au niveau quotidien et au niveau générationnel. Il garantit donc la stabilité du système capitaliste par la production continue d’une force de travail apte à produire la survaleur, au fondement du profit capitaliste. Si bien qu’il faut comprendre ici le terme de « reproduction » dans un double sens, à la fois reproduction de la force de travail et reproduction du système social. Néanmoins, contrairement au travail productif salarié, le travail reproductif ne produit pas directement de survaleur dans le cadre de la famille. En effet, ce n’est pas un travail producteur de valeur d’échange et de survaleur car il est effectué gratuitement, hors du marché, il ne prend pas la forme de marchandise, et n’a donc qu’une valeur d’usage. Cela ne change rien à son caractère central, dans la mesure où de lui dépend indirectement la production de la survaleur. Il est donc central au système capitaliste. Le fait de penser cette forme de travail en fonction de son rôle dans le système capitaliste (produire et reproduire la force de travail) permet également de voir que s’il s’effectue encore majoritairement hors des lieux de travail, dans le cadre de la famille, d’autres lieux sont tout autant centraux dans la production et la reproduction de la force de travail, comme par exemple les cantines, les crèches, les hôpitaux ou les écoles.

Linogravure Bureau Tempête-Be Cause Toujours !
Enfin, un point essentiel souligné par Lise Vogel est qu’il existe une contradiction inhérente et essentielle au système capitaliste entre la nécessité de produire de la survaleur et la nécessité de produire et reproduire la force de travail sur du court et du long terme. D’un côté, le travail reproductif est pris sur le travail salarié, qui est le seul à produire de la survaleur, mais de l’autre le travail reproductif est nécessaire pour garantir le travail salarié, sur du court et du long terme. C’est pourquoi le capitalisme va tendre à diminuer au maximum ce travail reproductif, et à faire en sorte qu’il soit le moins cher possible. Ainsi, on constate des évolutions dans l’organisation sociale du travail reproductif, qui sont le fruit d’un certain rapport de force féministe et de classe. Historiquement, on constate trois solutions classiques mises en place par le capitalisme pour économiser le coût reproductif : les femmes, l’État et l’immigration. Le travail reproductif peut ainsi être effectué gratuitement dans le cadre de la famille par les femmes, soit exclusivement, soit en plus de leur travail salarié. Dans ce cas, le travail reproductif est rémunéré indirectement via les salaires, notamment des maris. Le travail reproductif peut également être externalisé de la sphère familiale pour être mutualisé et coûter moins cher, notamment via les services publics. Cela a été en particulier le cas pendant les Trente Glorieuses. Enfin, dans un cadre national donné, les capitalistes peuvent avoir recours à une force de travail extérieure. Le recours à l’immigration permet ainsi de disposer de travailleur·se·s dont on n’a pas eu à assurer la production et la reproduction jusqu’à leur venue sur le territoire national.
Une évolution récente du travail reproductif dessine une nouvelle stratégie mise en place pour résoudre la contradiction entre travail productif et travail reproductif. On constate ainsi une « marchandisation » accrue du travail reproductif, qui entre de plus en plus dans la sphère salariée avec le développement du tertiaire et des services à la personne, mais aussi avec le phénomène récent d’« ubérisation ». Des pans entiers du travail reproductif, tant matériels qu’émotionnels entrent ainsi sur le marché (Uber pour les transports, Deliveroo pour la nourriture, Airbnb pour le logement, mais aussi pour ses « expériences » rémunérées). Même si dans ce cadre, le travail reproductif peut connaître une forme de « dégenrement », et être assuré par des hommes, on constate que les services à la personne demeurent majoritairement effectués par les femmes de classes populaires (car relevant de compétences construites socialement comme féminines), et parmi elles, nombre de femmes racisées. Or, on constate que ces secteurs sont précisément ceux qui connaissent un dynamisme fort en termes de lutte en France ces dernières années, ayant remporté beaucoup de grèves victorieuses, comme la grève du nettoyage à ONET ou dans les hôtels Holiday Inn.
Trois stratégies à l’épreuve
À partir de là, on peut considérer les trois stratégies principales qui s’offrent au mouvement féministe : la stratégie réformiste, la stratégie que j’ai qualifiée, faute de meilleur terme, d’« intersectionnelle », et la stratégie révolutionnaire.
La stratégie réformiste vise à obtenir l’émancipation et l’égalité des femmes et des minorités de genre en changeant progressivement la société et en privilégiant pour cela un outil principal, l’État. Cette stratégie s’est notamment développée depuis 1981 et la création d’un ministère aux Droits des femmes. Or, elle repose selon moi sur deux apories qui découlent de l’analyse que nous venons de faire plus haut. En effet, si on suit l’analyse de la reproduction sociale comme centre névralgique de l’oppression des femmes et des minorités de genre, on voit qu’il n’y a pas de réforme possible du système, tant oppression des femmes et des minorités de genre et système capitaliste sont interpénétrés. Le capitalisme aura toujours besoin que soit effectué gratuitement ou à bas coût le travail reproductif. Ensuite, cette stratégie repose selon moi sur une analyse erronée de l’État qui serait un instrument neutre, placé au-dessus des rapports sociaux de domination et que l’on pourrait faire jouer à son compte. Or ce n’est pas le cas : l’État est un des principaux instruments de production et de reproduction des rapports de domination, et lorsqu’il soutient la cause des femmes, il le fait toujours avec son propre agenda. Ce qui ne veut pas dire qu’il ne faut pas avoir une politique vis-à-vis de l’État et se désintéresser des nouveaux droits que l’on pourrait obtenir dès ici et maintenant. Mais il s’agit de voir que ces derniers ne seront obtenus que par l’imposition d’un rapport de force, c’est-à-dire par des luttes féministes.
La stratégie « intersectionnelle » est une réappropriation militante distincte de la théorie intersectionnelle, et qu’il faut donc bien distinguer. Dans les milieux militants s’est ainsi développée une lecture des oppressions uniquement en termes d’identité, lecture qui peut en venir à effacer les structures qui déterminent ces identités. L’oppression est analysée à un niveau purement individuel ou interindividuel, avec une attention très spécifique au langage comme vecteur principal de l’oppression. On n’analyse plus les bases économiques, politiques, sociologiques, structurelles des dominations, et on ne les pense plus qu’en termes de « privilèges », c’est-à-dire très exactement en tant que symptômes individualisés d’un système global. Certains individus ont des privilèges que d’autres n’ont pas. Dès lors, il ne s’agirait plus de changer les structures mais de changer les individu·e·s un·e par un·e. La politique qui est proposée est seulement celle d’une déconstruction de plus en plus poussée des individu·e·s, de même que celle de la constitution d’espaces safe, sécurisés, en non-mixité, où l’oppression ne s’exercerait pas. Cela ne veut pas dire que je ne pense pas que la non-mixité est un outil extrêmement utile, ni qu’il ne faut pas déconstruire ses pratiques et son langage. Le problème me semble plutôt se poser quand un moyen devient une fin en soi. Par ailleurs, on ne peut s’exclure totalement des rapports d’oppression en créant un espace qui serait véritablement safe, de même qu’on ne peut espérer changer tous les individus un à un. Enfin, ce genre de stratégie mène souvent à se couper du reste de la société, dans une démarche qui concerne surtout des individu·e·s ou des groupes d’individu·e·s. Et quand bien même on arriverait à créer un espace parfait : quid des autres ? Aucune libération ne devrait se faire au prix de la libération des autres. Sans compter que cela comporte un risque de sectarisme : en se coupant de l’immense majorité des gens, on entre dans une logique de l’élection et de la radicalité pour la radicalité, puisqu’on ne cherche pas à entraîner plus largement que nous. Ce repli sur soi conduit souvent à l’explosion des espaces concernés.
C’est à partir de ces limites que l’on peut définir une troisième stratégie, la stratégie révolutionnaire. De l’intersectionnalité théorique, on conserve l’idée de la nécessité de croiser les dominations, de ne jamais penser le féminisme indépendamment des questions de classe et de race. La théorie de la reproduction sociale permet justement de penser un système unitaire, fondé sur la production et la reproduction. Cette théorie nous permet également de comprendre que dans le maintien des oppressions, les structures sociales sont centrales (l’État, la justice, la police, l’école, la famille, etc.). Même s’il ne s’agit pas de laisser de côté totalement la déconstruction individuelle dès ici et maintenant, il est plus efficace de changer les structures pour changer les individus. Dès lors, si l’oppression des femmes et des minorités de genre est structurelle et centrale à la société et au fonctionnement capitaliste, seule une perspective révolutionnaire peut amener une fin réelle des oppressions.

Linogravure Bureau Tempête-Be Cause Toujours !
Sur quoi repose alors cette stratégie féministe révolutionnaire ? Sur deux piliers. Premièrement, si nous défendons une analyse unitaire des oppressions, alors notre réponse doit également être unitaire. C’est pourquoi la convergence des luttes est centrale. Si historiquement, les différents espaces politiques se sont développés séparément (le mouvement ouvrier, le mouvement féministe, l’antiracisme politique…), et s’il peut être nécessaire, pour des questions d’auto-organisation et de prise en compte de questions longtemps jugées secondaires, de les maintenir ponctuellement séparés, cela ne veut pas dire pour autant qu’ils sont destinés à le demeurer éternellement. Bien évidemment, la convergence des luttes ne se décrète pas. Pour rendre celle-ci possible, nous devons bien sûr faire des expériences communes, élaborer des mots d’ordre communs en amont, pour qu’un jour, nous convergions tou·te·s ensemble vers un même point (et non qu’un mouvement se subordonne à l’autre). Deuxièmement, si le travail reproductif est la base matérielle de l’oppression des femmes et des minorités de genre, alors en miroir leur arme principale est la grève féministe. La grève féministe est une grève totale, du travail salarié comme du travail domestique. Elle permet d’abord de dégager du temps aux femmes et aux minorités de genre : concrètement, cela leur permet par exemple d’aller à la manifestation du 8 mars, de faire une expérience politique sans avoir à se soucier, ni du travail, ni de la famille. Cela leur permet également d’expérimenter leur force – on entend ainsi souvent le slogan « quand les femmes s’arrêtent, tout s’arrête ». La grève féministe permet de montrer que le travail reproductif est un véritable travail, essentiel au fonctionnement de la société. Néanmoins, une grève féministe symbolique d’un seul jour est bien sûr insuffisante. Elle permet de reconstruire le mouvement féministe en France. Mais pour obtenir des avancées, il faudra non seulement étendre la grève dans la durée, mais aussi faire le lien avec l’ensemble du secteur salarié. Car la meilleure façon de croiser les deux perspectives stratégiques de la convergence des luttes et de la grève féministe est de construire une grève générale !
Pour aller plus loin :
Aurore Koechlin, La révolution féministe (éd. Amsterdam, 2019)
- NDLR : Le « foulard vert » est le symbole de cette lutte pour le droit à l’avortement légal, sûr et gratuit en Argentine.
- NDLR : en termes marxistes, la « survaleur » (ou « plus-value ») est la valeur ajoutée du « surtravail », c’est-à-dire la partie non rémunérée du travail effectué par le travailleur au profit du capitaliste. Celui-ci achète donc la force de travail du travailleur, mais à un prix inférieur au travail réellement effectué et empoche ainsi la survaleur dégagée par l’excédent de travail non rémunéré. Sur cette question, voir l’ouvrage de Marx : Salaires, prix et profits.
- Tithi Bhattacharya, « What is Social Reproduction Theory », vidéo filmée à Historical Materialism 2017, traduit par nos soins. Voir https://www.youtube.com/watch?v=Uur-pMk7XjY.